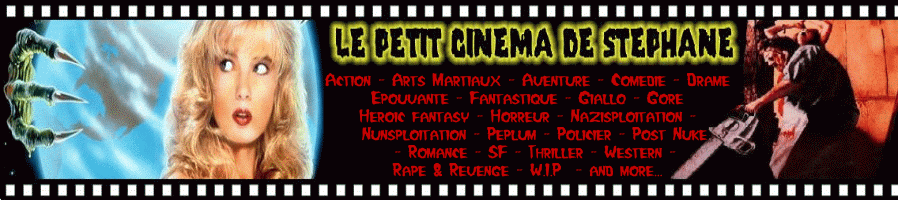LA FEMME SCORPION 4 : LA MELODIE DE LA RANCUNE
(Joshû sasori: 701-gô urami-bushi / Female Prisoner Scorpion: #701's Grudge Song)
Réalisateur : Yasuharu Hasebe
Année : 1973
Scénariste : Tooru Shinohara
Pays : Japon
Genre : Drame, W.I.P.
Interdiction : -16 ans
Avec : Meiko Kaji, Masakazu Tamura, Yumi Kanei, Sanae Nakahara...
L'HISTOIRE : Toujours en cavale, Nami Matsushima se faire prendre par l'inspecteur Kodama mais parvient encore à s'enfuir. Blessée, elle trouve de l'aide auprès de Yasuo Kudo, un technicien travaillant dans un cabaret de strip-tease. Ayant lui aussi subit des violences policières de par le passé, Kudo va tout faire pour que Kodama ne mette pas la main sur la femme scorpion...
MON AVIS : Déçue par la tournure qu'à fait prendre le réalisateur Shunya Ito à la saga avec l'épisode 3 (le pourtant très réussi La Tanière de la Bête), la firme Toei décide de le remplacer et de produire rapidement un quatrième volet aux aventures de Nami. Ce sera donc La Mélodie de la Rancune, mis en scène par Yasuharu Hasebe, toujours en 1973 et toujours avec l'actrice Meiko Kaji, dont ce sera la dernière participation en tant que femme scorpion. Ce nouveau metteur en scène est-il parvenu à assurer comme Shunya Ito ? La réponse est non. On assiste à la première grosse baisse de régime de la saga, la faute à une réalisation académique, sans réelle saveur ni prise de risque, auquel on ajoutera un scénario pas franchement folichon et qui en oublie presque son héroïne, au profit du personnage de Yasuo Kudo. Ce dernier, interprété par Masakazu Tamura, prend en effet une place prépondérante dans l'histoire et s'il assiste Nami, et que cette dernière en tombera même amoureuse, on regrette que Yasuharu Hasebe s'intéresse plus à lui, lui offrant de nombreuses scènes durant une bonne partie du métrage, tandis que Meiko Kaji attend patiemment son retour, restant planquée pour échapper à l'inspecteur. Résultat : baisse de rythme et scènes répétitives (la police les débusque, ils s'enfuient dans une nouvelle planque ; la police les débusque, re-fuite...). Plus intéressant est sans conteste le personnage de l'inspecteur justement ! Une vraie ordure, une pourriture de la pire espèce, qui n'hésite pas à maltraiter ceux qu'il arrête, et lors d'un flashback, on découvrira que Yasuo Kudo a déjà eu maille à partir avec lui. Une séquence très cruelle, violente et sadique, qui fera certainement grimacer de douleur la gent masculine. Ce vil monsieur versera dans la cruauté tout au long du film et on n'a qu'une envie, que Nami lui règle son compte ! Cette partie du film mettant en avant la traque et la relation Nami / Kudo, sans être mauvaise, se montre très inférieure aux trois précédents volets, que ce soit en terme d'ambiance, de mise en scène, d'originalité ou de recherche visuelle. Une baisse de régime flagrante qui nous fait clairement comprendre que la Toei a fait le mauvais choix en évinçant Shunya Ito. Une fois Nami rattrapée et à nouveau envoyée en prison, on revient au genre du women in prison et on se dit que La Mélodie de la Rancune va peut-être enfin décoller véritablement. Manque de bol, tout est filmé sans génie aucun et le réalisateur se contente de recycler les clichés inhérents au genre, sans jamais tenter de les transcender ou d'apporter une once d'imagination aux séquences se déroulant dans la prison. Il faudra alors attendre un ultime rebondissement permettant à Nami de s'évader à nouveau pour que le film se pare d'une séquence somptueuse, nous ramenant à La Femme Scorpion de 1972. La vengeance organisée de Kodama envers Nami constitue le meilleur moment et ce ciel qui passe du rouge au bleu est de toute beauté et nous offre un vrai plaisir visuel. L'ultime scène, attendue, replonge dans le classicisme et parachève un long métrage qui se révèle au final assez décevant et qui clôture, pour un temps, une saga de très bonne qualité compte tenu des trois premiers épisodes.
NOTE : 3/6