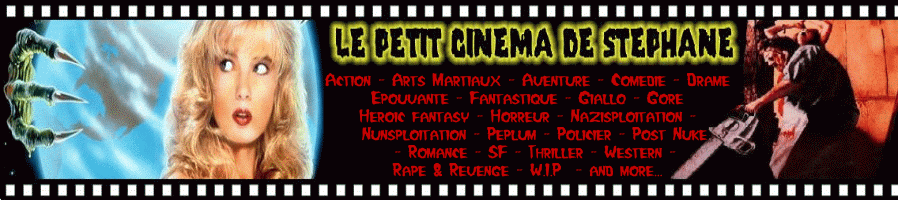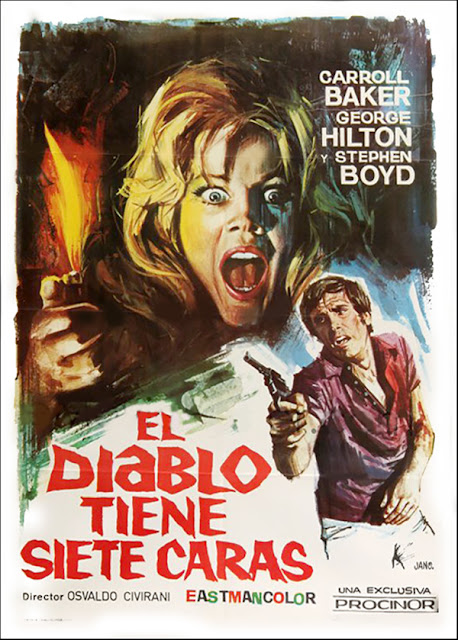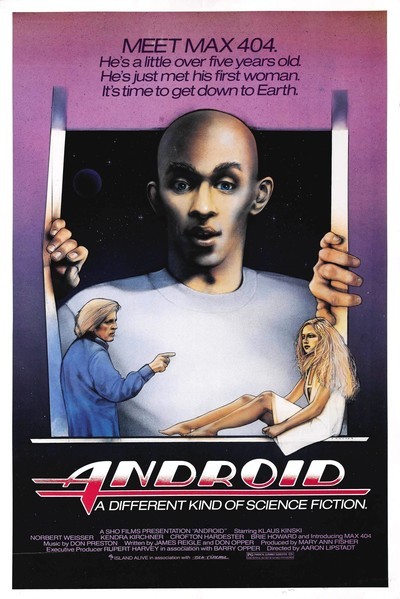DEATH STONE
(Kadaicha / Stones of Death)
Réalisateur : James Bogle
Année : 1988
Scénariste : Ian Coughlan
Pays : Australie
Genre : Fantastique, Horreur
Interdiction : -12 ans
Avec : Zoe Carides, Tom Jennings, Eric Oldfield, Natalie McCurry, Steve Dodd...
L'HISTOIRE : Des adolescents font des cauchemars dans lesquels ils voient un ancien sorcier aborigène leur donner une Kadaicha, une pierre antique dotée de pouvoirs maléfiques. A son réveil, l'une des adolescentes trouve la fameuse pierre sur son oreiller. Peu de temps après, elle meurt dans d'atroces conditions, apparemment déchiquetée par un animal. Les cauchemars se poursuivent et l'un après l'autre, les jeunes de ce quartier résidentiel se retrouvent en possession de la pierre et trouvent la mort. Gail Sorensen, terrifiée par la mort de ses amis, tente de découvrir la source de cette apparente malédiction. Son père, promoteur immobilier, en sait peut-être plus qu'il ne le dit...
MON AVIS : Pour son premier film derrière la caméra, on ne peut pas dire que James Bogle a fait preuve de beaucoup d'originalité. Réalisé en 1988, son Death Stone pille allègrement deux classiques 80's : Poltergeist et Les Griffes de la Nuit. Du film d'Hooper / Spielberg, il reprend l'idée des projets immobiliers construits sur un ancien cimetière, aborigène dans le film qui nous intéresse ici, ce qui va déclencher le courroux d'un sorcier mort depuis belle lurette. Du chef-d'oeuvre de Wes Craven, il emprunte quasiment tout le reste, à savoir une bande d'ados victimes de cauchemar récurrent et vivant dans un quartier résidentiel, des rêves qui deviennent réalité, des objets vus en rêve qui apparaissent pour de vrai, un père de famille qui connaît la raison et le pourquoi des meurtres des amis de sa fille et j'en passe. Malheureusement, James Bogle n'a pas le talent de ses illustres prédécesseurs et son Death Stone, même s'il n'est pas désagréable à regarder, a bien du mal à soutenir la comparaison avec les films dont il s'inspire et ne devrait pas laisser de trace impérissable chez ceux qui vont le visionner. Le casting, principalement composé d'adolescents donc, remplit sa fonction première, à savoir servir de chair fraîche à l'esprit vengeur du sorcier aborigène. Celle qui s'en sort le mieux est l'actrice principale (ça tombe bien !), la blondinette Zoe Carides, qui joue plutôt bien et fait tout ce qu'elle peut pour rendre son personnage crédible. Dans l'ensemble, les filles assurent plus que les garçons au niveau de leur jeu mais bon, aucun ne remportera un Oscar de toute façon. Et notre sorcier aborigène dans tout ça ? A-t-il le charisme de Freddy Krueger ? A cette question fortement existentielle, je répondrais avec un "non" bien tassé ! Il faut dire que ce méchant personnage n'a pas réellement de forme attitrée, du moins lorsqu'il se met à massacrer nos jeunes ados. Bon, massacrer est un terme un peu fort mais c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. En fait, l'esprit vengeur du sorcier va prendre la forme d'animaux divers pour commettre ses méfaits : un chien enragé qui va déchiqueter sa victime, une araignée au venin mortel qui va en piquer une autre directement dans l'oeil (beurk !), ou bien une anguille de la taille d'un anaconda qui va venir noyer une malheureuse qui voulait juste profiter de sa baignade dans un lac. Ça, c'est beau sur le papier, mais la réalité est un peu moins joyeuse puisque, hormis l'araignée, on ne verra pas grand chose lors des attaques, principalement celle de la pseudo-anguille, totalement invisible vu l'opacité de l'eau du lac. Niveau effusion de sang, on sera plutôt déçu également puisque seul le résultat de ces agressions animales nous sera présenté. Qui dit malédiction dit rituel de défense et notre pauvre héroïne, qui a tout compris quand aux travaux de son papa et son irrespect envers les aborigènes morts et enterrés sous le béton (l'argent, toujours l'argent), va devoir trouvé une aide pour se débarrasser de son épée de Damoclès, ayant reçu la pierre de Kadaicha et connaissant le sort qui l'attend, à savoir la mort. Cette aide, elle va la trouver en la personne de Billinudgel, un aborigène vivant dans les parages ! Ça tombe rudement bien vous trouvez pas ? On remerciera le scénariste Ian Coughlan d'y avoir pensé, ça va peut-être faciliter la vie de notre héroïne qui panique de plus en plus. Faut dire que c'est l'hécatombe parmi ses amis donc on la comprend. Par chance, ce vieil aborigène, interprété par Steve Dodd (l'aveugle dans Matrix), en connaît un paquet sur la question et sur les pierres de Kadaicha. Comme sa fille lui demande d'aider Gail et ses amis, il va accepter et le voici revêtu de jolies peintures aborigènes sur le corps, afin de se livrer à un puissant duel contre l'esprit du sorcier. Bon, encore une fois, "puissant duel" est exagéré mais je sais que vous aimez saliver. En gros, il va danser et utiliser un talisman pour détruire le squelette du sorcier hein, rien de plus. Mais bon, dit comme ça, ça attire moins le client, faut donc enrober un peu. Après, Death Stone, malgré ses défauts et son manque d'originalité flagrant, ça reste regardable, c'est pas non plus une purge infâme, loin de là, mais ça ne transcende rien et ça s'oublie aussi vite que ça s'est vu. Au niveau du cinéma fantastique australien, on a vu bien mieux, ça c'est certain.